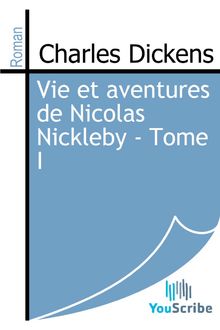Vie et aventures de Nicolas Nickleby - Tome I , livre ebook
371
pages
Français
Ebooks
2011
Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus
Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement
Découvre YouScribe en t'inscrivant gratuitement
371
pages
Français
Ebooks
2011
Vous pourrez modifier la taille du texte de cet ouvrage
Obtenez un accès à la bibliothèque pour le consulter en ligne En savoir plus
Publié par
Date de parution
30 août 2011
Nombre de lectures
134
EAN13
9782820602558
Langue
Français
Publié par
Date de parution
30 août 2011
Nombre de lectures
134
EAN13
9782820602558
Langue
Français
Vie et aventures de Nicolas Nickleby - Tome I
Charles Dickens
Collection « Les classiques YouScribe »
Faitescomme Charles Dickens, publiez vos textes sur YouScribe
YouScribevous permet de publier vos écrits pour les partager et les vendre. C’est simple et gratuit.
Suivez-noussur :
ISBN 978-2-8206-0255-8
CHAPITRE PREMIER. – Introduction générale.
Il y avait une fois, dans un coin du Devonshire, un digne gentleman du nom de Godefroy Nickleby, qui avait attendu un peu tard pour se décider à se marier. Comme il n’était ni assez jeune ni assez riche pour aspirer à la main de quelque héritière, il avait épousé, par pure affection, une vieille inclination. La dame, en le prenant, n’avait pas eu non plus d’autre motif. Ce n’est pas la première fois que l’on voit deux personnes, qui ne peuvent pas se permettre de jouer de l’argent, prendre néanmoins les cartes et se faire vis-à-vis pour jouer tranquillement ensemble une partie de pur agrément.
Peut-être des esprits chagrins, qui se plaisent à tourner en ridicule la vie matrimoniale, me reprocheront-ils de n’avoir pas plutôt comparé ce couple modeste à deux champions de nos boxes anglaises qui, voyant les fonds bas et les souteneurs rares, aiment mieux, par un goût chevaleresque pour leur art, se mesurer ensemble, pour le seul plaisir de s’entretenir la main. Et je ne puis disconvenir que, sous un certain rapport, la comparaison ne s’appliquerait pas mal ici. Car, de même que les deux héros de la boxe font circuler, après la lutte, un chapeau à la ronde pour recevoir de la générosité des spectateurs le moyen d’aller se régaler ensemble, de même M. et Mme Godefroy Nickleby, une fois la lune de miel disparue, jetèrent autour d’eux un regard soucieux sur le monde, pour envisager les chances qu’il pourrait leur offrir d’ajouter quelque chose à leurs ressources, le revenu de M. Nickleby, au moment de son mariage, flottant entre quinze cents et deux mille francs de rente au plus.
Il y a bien assez de monde sur la terre, bon Dieu ! Et particulièrement à Londres, où M. Nickleby faisait alors sa résidence, on n’entend guère se plaindre du défaut de population. Eh bien ! on ne saurait croire combien on peut regarder longtemps dans toute cette foule, sans y découvrir le visage d’un ami. Ce n’est pourtant que trop vrai. M. Nickleby en fit l’expérience. Il eut beau regarder, regarder tant, que ses yeux en devinrent aussi tristes que son cœur, pas un ami n’apparut, et lorsque, fatigué de chercher, il ramena ses regards sur son intérieur, il n’y trouva pas grande consolation à ses recherches infructueuses. Un peintre, qui a trop longtemps fixé la vue sur des couleurs éblouissantes, a la ressource de rafraîchir ses yeux troublés en les reportant sur quelque teinte plus foncée et plus sombre, mais, pour M. Nickleby, tous les objets qui s’offraient à ses regards étaient d’un noir si lugubre qu’il aurait été charmé d’y trouver plutôt, au risque d’en être ébloui, quelque contraste éclatant.
Enfin, au bout de cinq ans, lorsque Mme Nickleby eut fait présent de deux fils à son époux, et que ce gentleman dans l’embarras, préoccupé de la nécessité de pourvoir à la subsistance de sa famille, songeait sérieusement à aller prendre une assurance sur la vie pour le premier trimestre, et puis à se laisser choir après cela par accident du haut de la fameuse colonne, il reçut un matin par la poste une lette bordée de noir qui l’informait que son oncle, M. Ralph Nickleby, venait de mourir, et lui avait laissé en totalité son petit avoir, montant à la somme de cent vingt-cinq mille francs.
Jusque là le défunt n’avait guère donné signe de vie à son neveu. Une fois cependant il lui avait envoyé pour son fils aîné, que, par une prévoyance utile, le père avait décoré du nom de baptême de son grand-oncle, une cuiller d’argent, dans un étui de maroquin. Comme l’enfant n’avait pas grand’chose à manger avec la cuiller, cela pouvait passer pour une moquerie détestable de ce qu’il était né sans avoir seulement, à l’usage de sa bouche affamée, cette pièce d’argenterie intéressante. Aussi M. Nickleby, qui n’avait pas été gâté par la générosité du cher oncle, en pouvait croire à peine ses yeux quand il lut la lettre funèbre qui lui annonçait cette consolante nouvelle. Cependant ses informations ne firent que la confirmer avec exactitude. Le bon vieux gentleman avait eu d’abord, à ce qu’il paraît, l’intention de laisser tout son bien à la Société royale d’humanité ; il avait même fait un testament à cet effet. Mais cette institution charitable ayant eu le malheur, quelques mois avant, de sauver la vie à un pauvre parent des Nickleby, auquel il servait une rente de dix-sept francs quarante centimes par mois, il avait, dans un accès d’exaspération bien naturelle, révoqué, dans un codicille, le legs fait à la Société, en faveur de M. Godefroy Nickleby, et il n’avait pas manqué d’y faire une mention spéciale de son indignation, non-seulement contre la Société, qui avait eu la maladresse de sauver la vie à ce malheureux, mais contre le malheureux lui-même qui s’était permis de se laisser sauver la vie par la Société d’humanité.
M. Godefroy Nickleby employa une partie de cet héritage à l’acquisition d’une petite ferme près de Dawlish, dans le Devonshire, et s’y retira avec sa femme et ses deux enfants pour y vivre à la fois de l’intérêt le plus élevé que pourrait lui rapporter le reste de son argent, et du petit produit qu’il pourrait tirer de son domaine. Il y réussit si bien qu’à sa mort, quelque quinze ans après cette époque, quelque cinq ans après la perte de sa femme, il put laisser à son fils aîné Ralph soixante-quinze mille francs écus, et à Nicola, son cadet, vingt-cinq mille francs en sus de la ferme, qui constituait une terre domaniale aussi petite qu’on pût le souhaiter.
Ces deux frères avaient été élevés ensemble dans une pension d’Exeter. Et, pendant leur sortie de chaque semaine, ils avaient souvent recueilli, des lèvres de leur mère, le long récit des souffrances qu’avait endurées leur père dans ses jours de pauvreté, et de l’importance dont avait joui feu leur oncle dans ses jours d’opulence. Ces souvenirs produisirent sur eux des impressions très différentes. Pendant que le plus jeune, qui était d’un esprit timide et contemplatif, n’y trouvait qu’un avertissement sérieux de fuir le grand monde et de s’attacher plus que jamais à la routine paisible de la vie des champs, Ralph, l’aîné, raisonnant sur ces contes d’autrefois si souvent répétés, en tirait la conséquence qu’il n’y a pas d’autre source de bonheur et de puissance que la richesse, et que tous les moyens sont bons pour l’acquérir, pourvu qu’ils ne soient pas précisément criminels. « Ainsi, se disait Ralph en lui-même, si l’argent de mon oncle n’a pas absolument produit grand bien pendant sa vie, il en a produit beaucoup après sa mort ; car c’est mon père qui en profite maintenant et qui me le garde pour plus tard ; n’est-ce pas un but très vertueux ? Et, pour en revenir au vieil oncle, il en a aussi tiré un grand bien, puisqu’il a eu le plaisir d’y penser toute sa vie et d’être un objet d’envie et de déférences respectueuses pour tout le reste de la famille. » Et Ralph ne manquait jamais de terminer ces soliloques intérieurs par cette conclusion qu’il n’est rien tel que l’argent.
Trop conséquent pour s’en tenir à la théorie ou pour laisser ses facultés se rouiller, même à un âge si tendre, dans de pures abstractions d’esprit, ce garçon plein d’avenir commença dès l’école le métier d’usurier sur une échelle limitée, plaçant d’abord à gros intérêt un petit capital de crayons d’ardoise et de billes, puis étendant graduellement ses opérations financières, si bien qu’elles finirent par comprendre la monnaie de billon du royaume de la Grande-Bretagne, sur laquelle il spécula avec un profit considérable. Et n’allez pas croire qu’il embarrassât l’esprit de ses débiteurs par des calculs fastidieux en chiffres, ou des concordances avec des tables de Barème. Sa règle d’intérêt était bien simple, elle se résumait dans cette maxime qui valait son pesant d’or : Quatre sols pour deux liards. C’était un adage précieux pour simplifier les comptes, et sa forme familière le rendait plus propre encore à se graver dans la mémoire que toutes les règles de l’arithmétique. Aussi nous ne saurions trop le recommander à l’attention des capitalistes, petits ou grands, et plus particulièrement à celle des courtiers de change et des escompteurs de billets. Au reste, il faut rendre justice à ces messieurs, il y a déjà bon nombre d’entre eux qui n’ont pas cessé d’en faire un usage quotidien, avec un succès remarquable.
Le jeune Ralph, par le même principe, et pour éviter tous ces calculs minutieux et subt